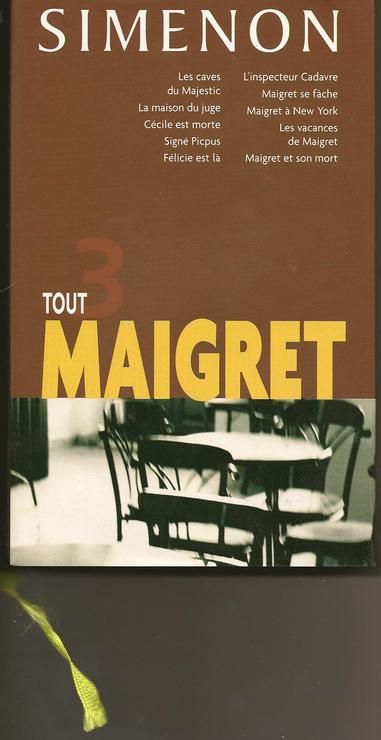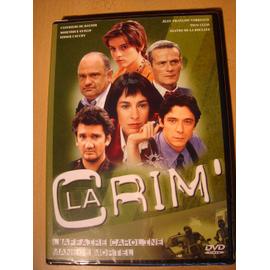L’idée de ce « Patron incognito » pourrait être intéressante, n’était-ce le côté « voyeur » imposé par ce format de Téléréalité diffusé sur M6, produit par Endemol et qui est l’adaptation du Undercover Boss de la chaîne britannique Channel 4 . Au premier abord, l’expérience semble concluante. Le patron découvre les conditions de travail de ses employés, et s’extasie devant leur courage, leur professionnalisme, et le soin particulier qu’ils mettent à« tutorer » ce nouveau collègue, il est vrai bien empoté. La prévention des risques est scrupuleusement respectée, les gestes et postures soigneusement inculqués et appliqués. Il n’y a qu’à une occasion où il est permis de s’interroger, c’est lorsque l’on voit Guillaume porter un bambin sur ses épaules, en pleine rue, ce que ne semble pas remarquer sa tutrice, elle qui est habituellement si vigilante sur la sécurité et sur la proximité qu’il est interdit de cultiver avec les enfants.
L’émotion, incontournable dans le genre téléréalité, nous
est fournie par cette galerie de portraits d’individus authentiques, prêts à
partager un repas avec un inconnu, mais ne le ménageant pas, à grands coups de
mise en scène. Patricia se plaint devant la caméra, mais en aparté :
« je n’ai pas que ça à faire », pendant que son Pdg se débat avec un
fer à repasser ; elle se retiendrait presque pour ne pas le massacrer.
C’est d’ailleurs le second effet « spectaculaire » : voir le
dirigeant se dépatouiller avec le nettoyage des toilettes, se démener avec une
cisaille pour tailler une haie, ou appréhender le changement de la couche
culotte d’un bébé.
Enfin, arrive le grand moment où chacun des collègues est
convoqué au siège pour voir leur patron baisser le masque et révéler son
identité. Il est légitime de se demander ce que l’on a bien pu dire à ces
salariés pour les faire venir. Et comment justifier la présence de la caméra
pour cette scène finale ? Aucune explication n’est avancée, alors que pour
le reste de l’émission, c’est le prétexte d’un reportage sur un « chômeur
en reconversion » qui justifie la présence d’une équipe de télévision. Mais
ce n’est pas la moindre des incohérences. Car si cette émission est une
excellente publicité pour les services à la personne, on y entend même parler
des avantages qu’ils peuvent générer, et aussi un outil de promotion idéal pour
la société O2, il est légitime de se poser quelques questions essentielles.
Pourquoi, par exemple, faut-il attendre cette expérience pour que l’entreprise
se rende compte de tels dysfonctionnements, dont l’un des plus criants est sans
doute le manque d’hygiène dans l’une des agences, un comble pour des experts du
nettoyage ! Mais le plus croustillant c’est de noter le manque de respect
de différentes procédures internes dont la responsable nationale n’est autre
que l’épouse de Guillaume Richard. Mais ça, M6 ne le relève pas. Pas plus qu’elle
ne peut expliquer comment fera Patricia pour assurer sa tâche avec un quart
d’heure de travail effectif en moins puisque c’est le temps qu’elle doit
normalement prendre pour ses déplacements. A moins que ne ce soit au détriment des
clients ?
Mais le plus gros reproche que l’on peut faire à notre
entrepreneur à la tête de la 1ère entreprise de services de France
et ses 140 agences, forte de ses 27 000 clients, c’est que ses salariés doivent
attendre cette émission pour accéder à leurs souhaits d’évolution. Heureusement,
il suffit d’appuyer sur le bouton M6 de l’ascenseur social pour voir leurs
souhaits exaucés. Le spectateur ne manquera pas d’être impliqué, car si chacun
d’entre nous faisait appel à O2, cette entreprise pourrait peut-être enfin
proposer des temps pleins à ses puéricultrices. Ou embaucher sans aucune
qualification, comme elle fait avec ce demandeur d’emploi, de parfaits inconnus
pour leur confier les maisons, les jardins ou pire, les enfants de ses clients ?
Et déléguer à de jeunes diplômés, sans aucune formation interne particulière le
recrutement de ces nouveaux collaborateurs, comme on le voit dans l’une des
agences ? Enfin, nous ne saurions que trop conseiller à notre super Pdg de
débarrasser la table après le déjeuner avant de retourner travailler, ou du
moins de le proposer au collègue qui l’a généreusement invité, et surtout de ne pas se vautrer sur le lit
dans sa chambre d’hôtel, les chaussures au pied. Un patron se doit d’être
exemplaire, le respect du travail des autres est la première des qualités ...
Guillaume Richard au Salon des services à la personne en 2011 :
Sur cette émission, voir également l'article de Management de Mars 2012.