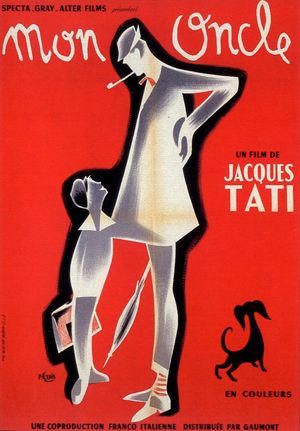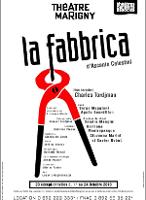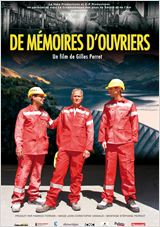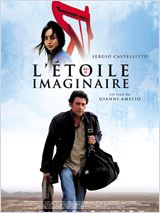Boulevard du Palais est une série policière française diffusée depuis 1999. Elle met en scène des personnages récurrents, aux personnalités bien trempées, qui gravitent autour de la "petite juge"
Nadia Lintz interprétée depuis l'origine par
Anne Richard.
Jean François Balmer, dans le rôle du Commandant de police judiciaire
Rovère, devenu alcoolique suite à des accidents de la vie, est l'autre personnage principal. Il est assisté de l'inspecteur
Di Meglio (
Philippe Ambrosini ) et d'un médecin légiste poète et philosophe à ses heures,
Hannibal Pluvinage, dont les habits sont endossés par l'excellent
Olivier Saladin. C'est lui qui au détour d'un échange donnera l'explication de l'intitulé du titre de cet épisode, "
trepalium" qui désignait un engin de torture et dont le mot "travail" tire son étymologie. Car c'est dans le monde de l'entreprise que se déroule l'action de ce nouvel opus, avec pour point de départ, le suicide d'un cadre de
TSA,
Patrick Bello, qui adopte une manière originale, puisqu'il précipite l'automobile dans laquelle il a pris place contre un obstacle dans un atelier de bancs de tests de sécurité situé au sous sol de l'entreprise.
L'intrigue prendra un tour inattendu, puisque l'on découvrira finalement après un second suicide requalifié en homicide, que la dirigeante était en train de vendre l'entreprise qui compte 124 salariés à des concurrents allemands. C'est pour cette raison que, avec la complicité de son DRH,
Chauvel, elle a "spolié"
Bello d'un logiciel qu'il avait développé qui aurait pu entraver la cession. Le cadre, ne comprenant pas ce qui lui arrive glissera dans une spirale dépressive, bien entretenue par
Chauvel qui ira jusqu'à le harceler, lui reprochant son poids, son âge et même son hygiène en allant jusqu'à lui offrir du déodorant. Cette facette du harcèlement en entreprise semble la moins réaliste car la pression conduisant à une extrémité fatale est généralement plus sournoise. Elle est cependant assez bien décrite dans la première partie de l'épisode, notamment au travers des témoignages des différents personnages.

Son épouse d'abord, effondrée à l'annonce de la terrible nouvelle, qui se rendait compte que "son boulot le vidait de l'intérieur, on lui en demandait trop ou on ne lui demandait rien" ou son fils qui ajoute "il ne parlait pas de son boulot". Le discours du DRH est bien entendu teinté de mensonge, mettant le geste fatal du cadre sur le compte "d'une passe difficile, d'une inaptitude provisoire", mais l'entreprise ne lui en tiendra pas rigueur alors que "d'autres ne se seraient pas gênés pour le virer". Les dirigeants de l'entreprise évoquent aussi "des difficultés dans le couple" ainsi que "des rumeurs de relation avec une fille", une des anciennes salariées, elle aussi victime de pressions, et qui avait été licenciée "pour abandon de poste", mais après qu'un mél d'insultes ait été adressé à sa patronne depuis son poste informatique. C'était en fait le résultat d'une première manipulation du DRH.
La position du médecin du travail est plus ambiguë. Il est d'abord difficile de comprendre où elle se situe physiquement, tant elle semble impliquée dans l'entreprise. Les permanences régulières qu'elle assure au sein de l'établissement et qui génèrent cette impression sont très éloignées de la réalité. Elle expliquera "les troubles du sommeil" de
Patrick Bello par la pression infligée par "la nouvelle stratégie de l'entreprise", et déplorera le manque de communication qui se traduira entre autres par le "remplacement de la machine à café par des cafetières individuelles disséminées dans les bureaux". A l'issue du premier décès elle sera bien sûr partie prenante de la cellule psychologique constituée avec
Chauvel, un DRH décidément machiavélique qui introduira un logiciel mouchard dans le poste informatique de la thérapeute et qui fera aussi chanter sa patronne.
Les héros de la série de
France Télévision ont sur ce petit monde un regard distancié mais peu critique, restant dans leur rôle. La"
petite juge" rappellera la difficulté de "prouver le harcèlement" dans ce genre d'affaires, alors que
Pluvinage confirmera les troubles du sommeil de
Bello, qui "carburait aux calmants et somnifères". Le commandant
Rovère se limitera à observer que le DRH "n'est pas submergé par les rendez-vous" mais la fille adoptive du policier montrera toute l'incompréhension dont souffrent les victimes de harcèlement car elle ne comprend pas que l'on puisse "se foutre en l'air parce qu'on est pas capable de dire non à un chefaillon".
C'est l'inspecteur
Di Meglio qui sera le plus mordant, fidèle à son habitude, se lâchant d'un commentaire peu amène à l'attention du médecin du travail : "votre paie vient des cotisations patronales". La réalité n'est pas aussi simple, même si la médecine du travail est plutôt au service des employeurs, ce que les salariés ont du mal à comprendre. Ceux-ci se lamentent souvent du peu de profondeur des diagnostics des médecins du travail, mais ils ne doivent pas oublier que la mission de ces derniers lors des visites médicales n'est pas de contrôler la santé du personnel, mais de vérifier son aptitude. Dans le cas contraire, c'est le licenciement qui guette ...
En résumé, cet épisode reste assez réaliste, seules quelques concessions imposées par le scénario nous éloignent des conditions réelles de l'entreprise, à l'exemple du comportement du DRH. Il rappelle sous certains aspects un épisode le la série "La crim" traité dans
cet article de notre blog ou "Seule", cet excellent téléfilm qui fait l'objet de
l'article le plus lu de ce blog.