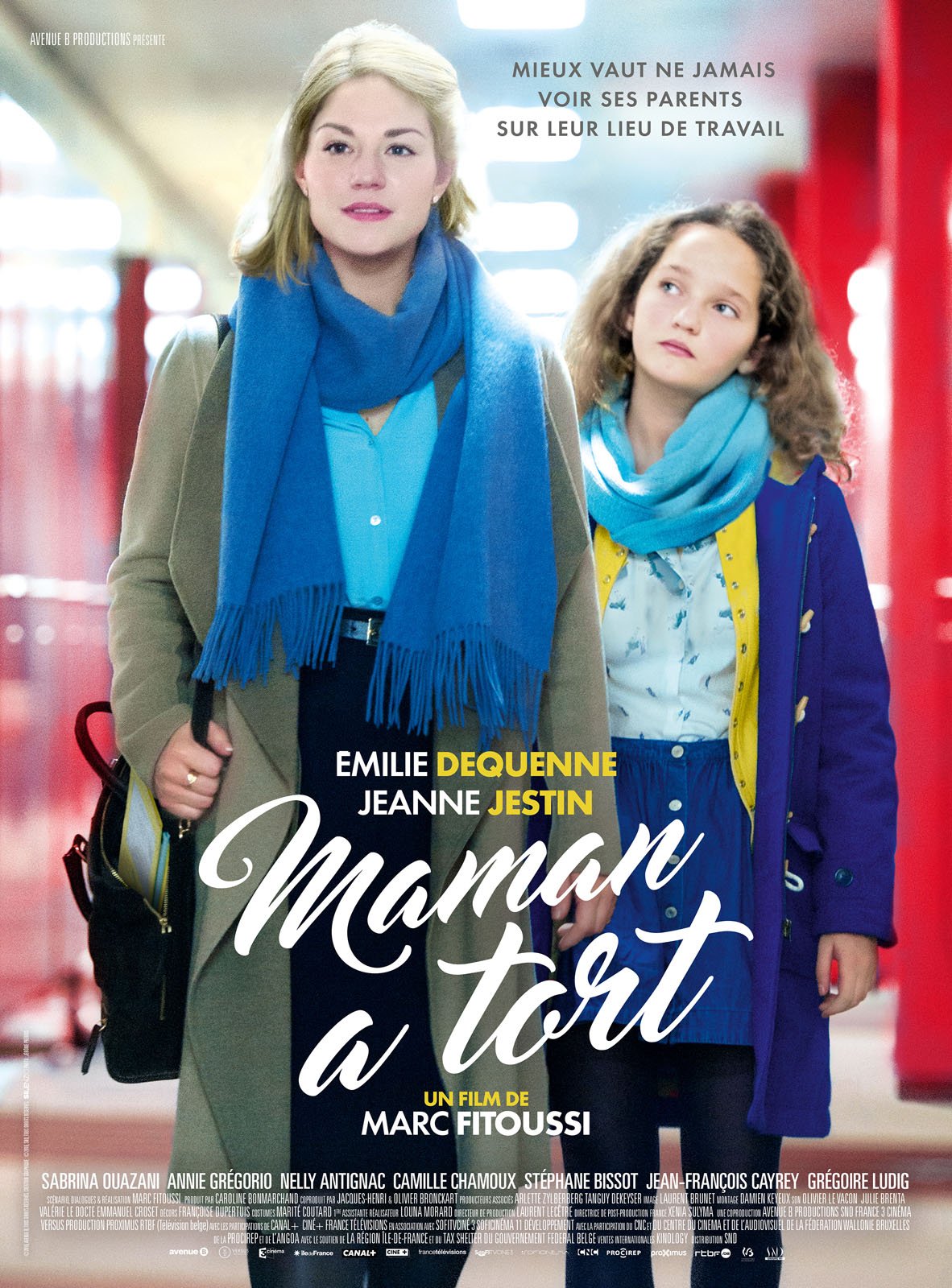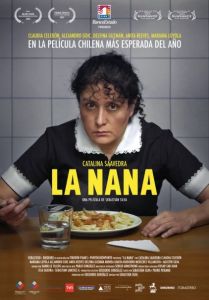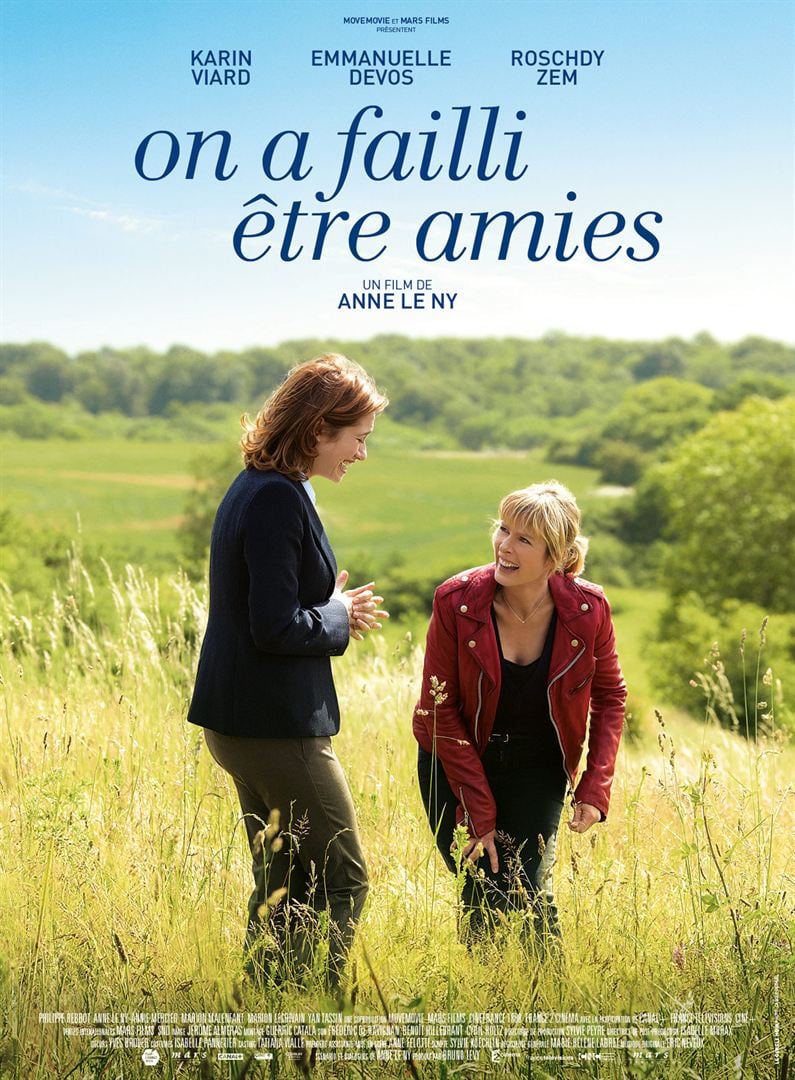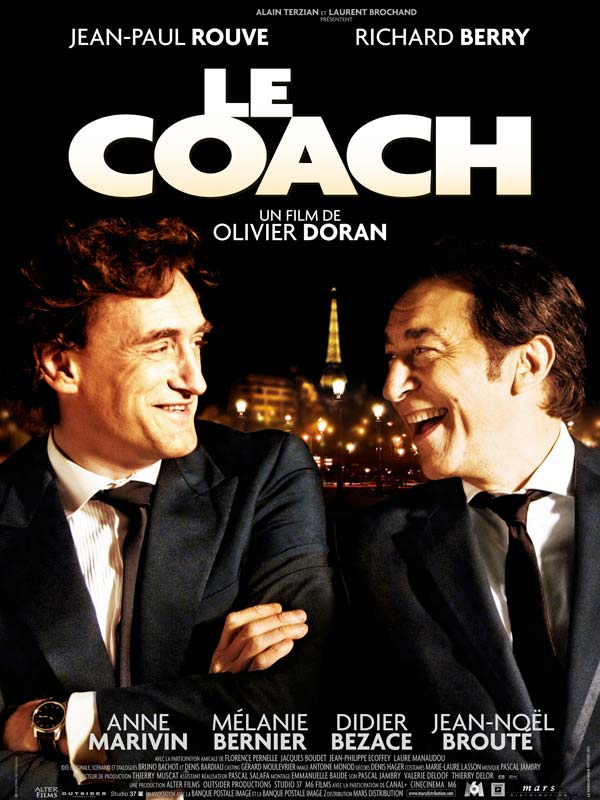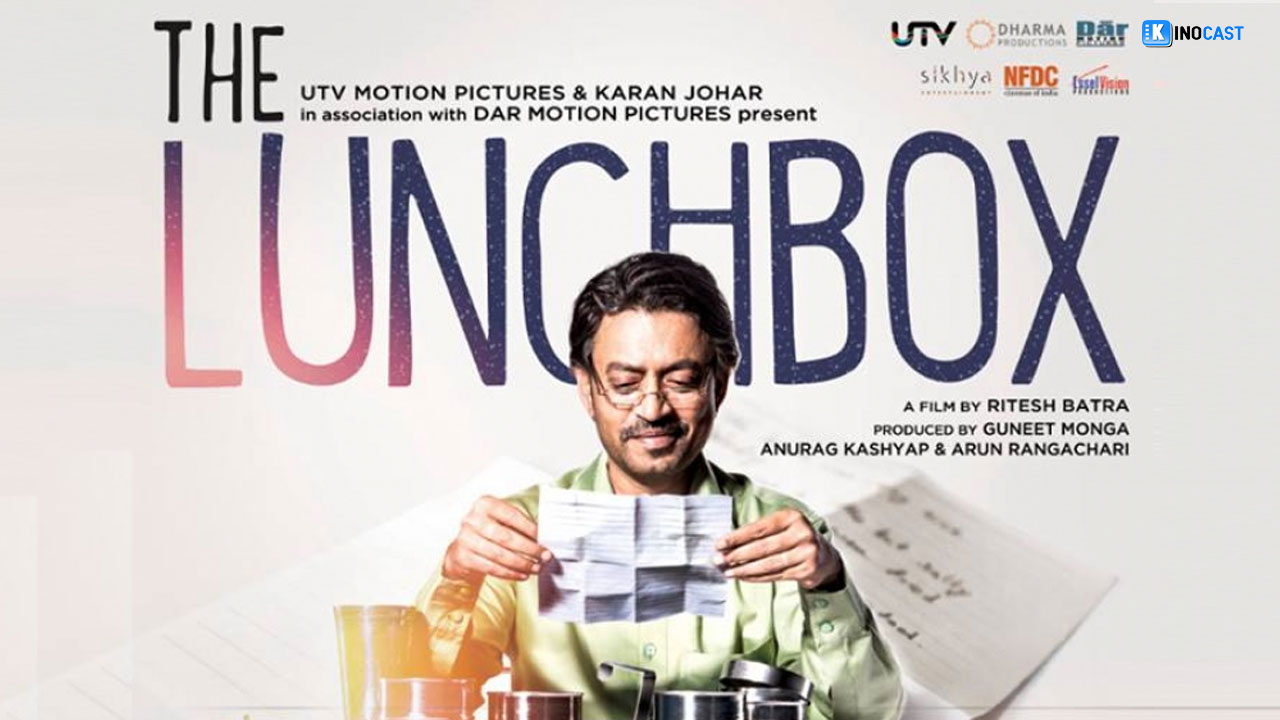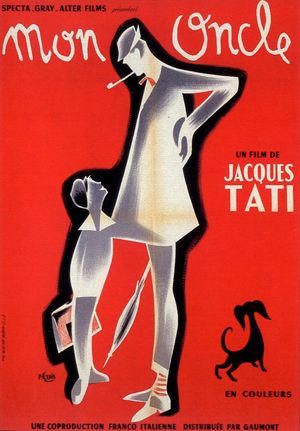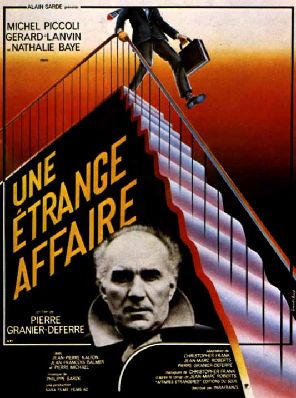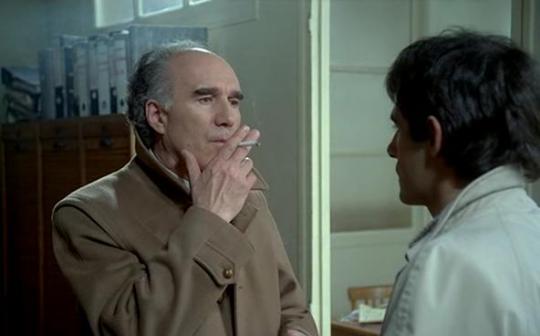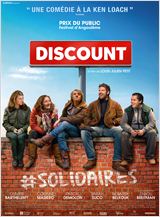Sous l'angle du monde du travail l'intérêt principal de ce film réside dans la vision qu'il offre de la façon dont la population masculine, essaie de s'en sortir, par le travail, ou par des expédients, sans tomber dans le trafic ou l'illégalité, même si, excepté peut-être celui du Parti Communiste, la plupart des emplois ne sont certainement pas déclarés. Mais nous n'aurons indication à ce sujet pour aucuns d'entre eux.
Afin de constituer un trousseau pour sa sœur, déshonorée par un vieux célibataire, mais aussi pour demander la main de Carmela (Maria Fiore) à son père, avec peut-être l'espoir d'intégrer l'entreprise familiale florissante de fabrication de feux d'artifices, Antonio remplira d'abord des bouteilles de limonade pour le compte d'un débit de boisson du village, vendra des légumes sur le marché, puis gagnera quelques pièces en assistant les cochers dont les calèches peinent à grimper la montée qui ponctue le trajet entre la gare et le bourg. A ce moment, il aurait dû occuper le poste de chauffeur de bus de la compagnie créée par ces mêmes cochers sous forme de coopérative dans le but de contrer les plans du Maire qui envisageait de mettre en place un service régulier de transports en bus. L'entreprise prendra fin avant même d'avoir commencé en raison du manque d'entente des associés.
Antonio sera donc successivement assistant du bedeau et colleur d'affiches puis coursier pour les propriétaires de 3 cinémas, parcourant les rues de Naples à bicyclette pour livrer les bobines de films, une scène qui fait immanquablement penser à "Nuovo Cinema Paradiso" film beaucoup plus récent de Giuseppe Tornatore. Il s'attirera les faveurs de la mère de famille puisque, en plus de son travail, il fait don de son sang pour favoriser la croissance de son garçonnet. Ce qui lui permettra d'accéder au titre de projectionniste, enfin un vrai métier, qu'il perdra aussitôt à cause de sa promise, aussi amoureuse qu'écervelée.
Dans cette période d'après-guerre telle qu'elle est dépeinte ici dans le sud de l'Italie, la région Campanie, pour être plus précis, le fait marquant est le manque cruel de travail et donc de ressources pour les familles. Les hommes se présentent chaque jour devant la grille d'enceinte de l'église et passent là une partie de la journée à attendre un hypothétique emploi, préférant parfois refuser un travail peu intéressant et pas beaucoup plus rémunérateur que les indemnités chômage, puisque le système a le mérite de déjà exister. Les emplois proposés, quand ils existent, sont ceux de manoeuvre, peu payés et peut-être rarement déclarés.