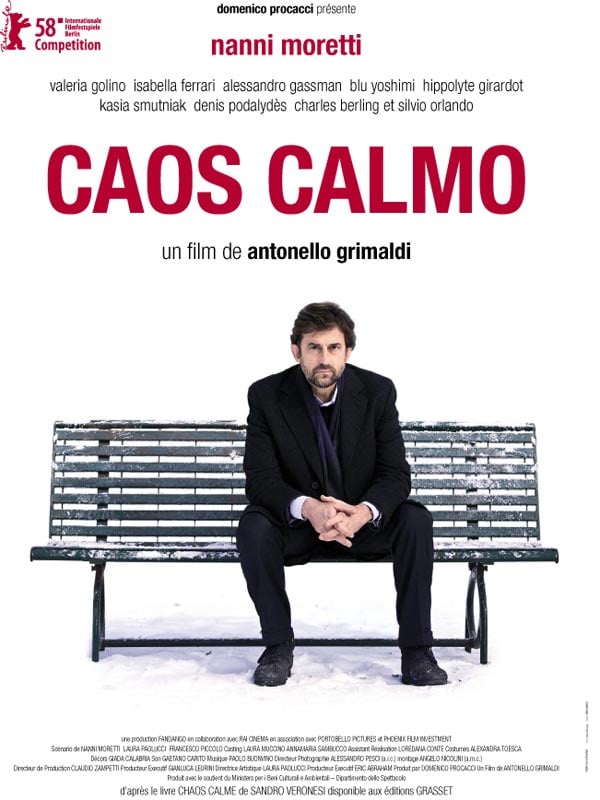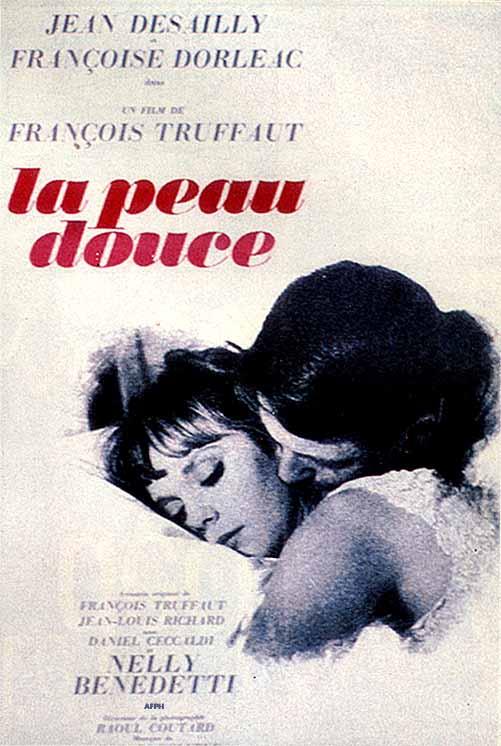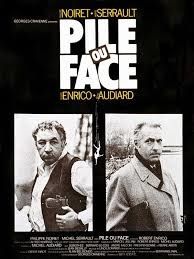#01 L’impact des fusions d’entreprises sur les organisations et les
salariés
Une fois de plus, l’entreprise n’est pas le cadre de l’intrigue de ce
roman italien qui a remporté le prix
Strega en 2006 et qui a
ensuite été porté à l’écran par
Antonello Grimaldi, avec dans le rôle-titre, l’un des acteurs
transalpins les plus réputés,
Nanni Moretti. Ce serait même plutôt le contraire puisque,
justement, le personnage principal délaisse son emploi de cadre supérieur au
sein d’une multinationale sur le point d’imploser sous le coup d’une fusion, et décide que "son travail sera de ne plus travailler". En
effet, le quadragénaire qui vient de perdre son épouse, accompagne sa fille
Claudia le jour de la rentrée scolaire,
et décide à l’improviste, de rester à
l’attendre toute la journée dans son véhicule, devant l’école.
Le lendemain et les jours suivants, il recommence. Ses collègues viennent
successivement lui rendre visite dans ce
bureau improvisé, sa grosse « Audi
A6 3000 » stationnée chaque matin devant l’école que fréquente sa
fille. Un jour c’est Enoch, le chef
du service du personnel qui vient s’épancher auprès de Pietro sur la fusion en cours. Il lui remet les 3 feuillets qu’il a
dactylographiés le matin même à 5 heures du matin, et dans lesquels il a mis
« tout ce qu’il avait sur le cœur » (Cf ci-dessous paragraphe #02).
Au travers du point de vue de ce DRH, curieusement affublé du titre de
« Chef du service du personnel »,
Sandro Veronesi
dresse une analyse remarquable, il synthétise très précisément les conséquences
structurelles et humaines des fusions d’entreprises. Sans militantisme aucun,
il met en exergue la valeur du capital humain de l’entreprise et sa capacité à
générer de la valeur. Il décrit avec une acuité quasi-scientifique les
répercussions sur les salariés de ces regroupements de multinationales ainsi
que les pathologies qu’ils risquent de développer par une somatisation de leur
stress et de leur mal-être. Il s’attache aussi à relever les conséquences
humaines sur les organisations, avec une disparition de la culture d’entreprise
et de la confiance, et sur le plan sociologique, une perte du plaisir de
travailler en équipe avec ses collègues qui deviennent de véritables rivaux. Et
de conclure par le constat d’une perte de compétences de l’entreprise et de l’échec
irrémédiable de ces méga-fusions.
Situées au 1er tiers
de ce livre, cette approche d’un des aspects des conditions de travail n’y occupe
qu’un plan secondaire, et pourrait même sembler incongrue par rapport à l’intrigue.
Le travail extrêmement documenté de l’auteur, étrangement renforcé par la mise
en gras des termes ou idées importants, en insuffle toute la valeur.
#02 L’analyse du chef du service du personnel
Les 3 feuillets remis par Enoch à Pietro commencent par sa définition
des fusions :
« Qu’est-ce qu’une fusion ? Une fusion est le conflit de deux systèmes de pouvoir qui
en crée un troisième pour des finalités
financières. Elle est conçue pour générer
de la valeur, mais la génération de valeur est un concept bon pour les
actionnaires, ou pour les banques d’affaires, pas pour les êtres humains employés dans les entreprises, pour qui au contraire
la fusion est le plus violent traumatisme
qu’on puisse leur infliger au travail. Une fois qu’on a trouvé l’accord sur la transaction, ce qui
n’est pas facile, on a tendance à croire que le plus gros est fait. Cette
conviction découle de la sous-estimation
que le monde de l’économie réserve au facteur
humain et, plus généralement, à la psychologie.
Mais c’est une erreur. Les principaux problèmes dans une fusion ne sont pas
liés au document qui la sanctionne. »
La lecture de la note écrite en Arial reprend : « Avant les
chiffres, en effet, une entreprise est faite par les hommes qui y travaillent, c’est-à-dire par ses salariés, et après l’annonce d’une fusion la réaction de tout
salarié à tout niveau est l’incertitude.
A qui dois-je me fier ? Qu’est-ce qui m’attend ? Va-t-on me garder ou
me renvoyer à la maison ? Mes fonctions vont-elles changer ? Comment
mes problèmes seront-ils résolus ? Réussirai-je à garder les privilèges
que j’avais conquis ? Aucun ne se soucie de génération de valeur tant que
la nouvelle organisation n’aura pas répondu à ces questions, en lui
garantissant une nouvelle légitimité.
Pendant une fusion, il faudrait parler
avec les salariés, les informer et les
tenir au courant le plus souvent possible ; le salarié a besoin de confiance, de sentir qu’on ne le
considère pas seulement comme un pion ;
on lui réserve en revanche un discours-standard,
pondu une fois pour toutes par quelques conseillers en communication interne,
qui a pour tout effet d’augmenter ses inquiétudes.
Ces déclarations aseptisées sur de futures synergies
qui ne touchent pas le personnel sont pure hypocrisie
puisque tout le monde sait que la seule garantie concrète pour générer de la
valeur sur les marchés est une réduction
des coûts de l’entreprise, et les réductions de coûts sont réalisées à 80 %
par des compressions de personnel. »
Pietro passe alors à la deuxième page : « Ainsi les salariés
pendant une période de fusion entrent ils dans une zone de constantes turbulences. Il s’agit d’une période
assez critique qui peut durer très longtemps et pendant laquelle le sentiment
dominant est l’angoisse. Une
angoisse qui, si on la néglige, d’individuelle
peut devenir collective ou même se
transformer en panique ; l’expérience au contact avec le
personnel pendant une fusion enseigne que l’impact
est double. Au plan physique, la machine humaine tend à sentir davantage de stress et de fatigue et à accentuer toutes les propensions naturelles à la somatisation, avec une augmentation
sensible des allergies, troubles respiratoires, cystites, migraines, dermatites,
et, chez les femmes, candidoses, aminorrhées (sic) et dysminorrhées (sic) ; tandis qu’an
plan psychologique, les esprits sont
envahis par l’incertitude, tout
événement suscite des émotions anxiogènes telles que la peur, l’angoisse, le découragement et la frustration qui, à leur tour produisent
de graves symptômes de dépression,
d’autant plus graves que les personnes concernées sont instinctivement poussées
à les refouler car elles appartiennent à une culture de pure performance, où l’existence de ce genre
de troubles est tout simplement inconcevable. »
Après avoir fait remarquer à Enoch son erreur sur l’orthographe de « aménorrhées »
et « dysménorrhées » que celui-ci s’empresse de corriger, Pietro
reprend le fil de sa lecture :
« Cet impact est plus dévastateur pour la tranche d’âge entre quarante et cinquante ans, quand
le potentiel d’adaptation est inférieur et que le risque de perdre au change
est beaucoup plus élevé. On a l’impression de régresser, on perçoit un sentiment d’injustice. Le traumatisme à absorber est énorme : on était
attaché à une culture d’entreprise,
à une équipe, à des collègues avec
qui on travaillait avec plaisir,
dans un esprit de corps. Quand on se
retrouve en face des autres, c’est
dur. Même s’il est précisé d’entrée de jeu que ce sont eux les « victimes », il s’agit bien de l’ennemi qui se matérialise. Hier
encore, on était en rude compétition
avec eux, soudain, les voici qui pénètrent notre environnement. On se sent envahi, ne serait-ce que physiquement
et on ressent le désir de les envoyer balader, de leur dire qu’on s’en sortait
très bien sans eux. Et au contraire, il faut travailler ensemble, et le choc est grand ; on a vu des
cadres provenant d’entreprises classiques, où les titres et la hiérarchie sont
sacrés na pas réussir à supporter de participer à des groupes de travail avec du
personnel provenant de l’autre entreprise, de rang hiérarchique nettement
inférieur, au nom d’une compétence commune contingente. »
Arrivé à la fin de cette deuxième page, Pietro se demande si Enoch ne
cherche pas finalement à le mettre mal à l’aise en lui soumettant ce texte,
pour lui rappeler qu’il peut lui aussi devenir chômeur, lui, Pietro, déjà affaibli
par le récent deuil. Il enchaîne avec la lecture du dernier feuillet :
« C’est une situation très
déstabilisante, et seulement trois catégories de personnes réussissent à le
supporter : les fidèles des fidèles,
ceux qui tournent leur veste et les collabos. Tous les autres risquent de
sombrer. Il faut développer une grande résistance,
physique et psychologique, pour ne pas s’écrouler et rares sont ceux qui y
parviennent sans une assistance
appropriée. Mais une telle assistance n’existe pas. Alors, la conséquence la
plus courante est que pendant les fusions, un grand nombre d’excellents
éléments quittent volontairement
leurs fonctions, avant même que la fusion soit achevée ; ce qui à courte
vue, est reçu positivement car l’étape suivante de la compression de personnel est allégée d’autant, alors que cela
représente au contraire une perte
sèche. Car les hommes et les femmes qui partent emportent avec eux leur savoir et leurs capacités techniques et en comparaison de la valeur virtuelle créée sur les marchés, le
résultat réel est un terrible appauvrissement. Voilà pourquoi on n’a
encore jamais vu de grande fusion ne pas échouer nom de Dieu, au bout d’un an
ou deux. »